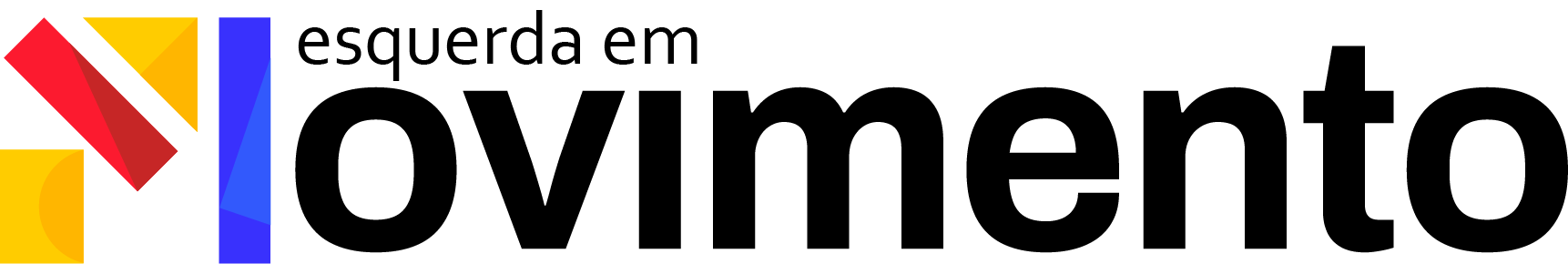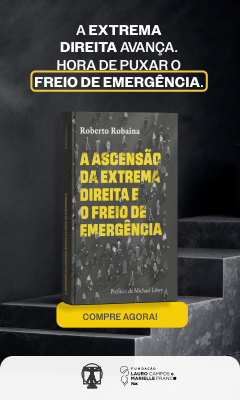Bolivie – ce qui a mal tourné
Une analyse de l’élection présidentielle bolivienne, dont les résultats marquent une défaite des candidats issus du camp de l’actuel gouvernement du MAS.
Une analyse de l’élection présidentielle bolivienne, dont les résultats marquent une défaite des candidats issus du camp de l’actuel gouvernement du MAS
Le résultat du premier tour des élections boliviennes a attiré l’attention. Ceux qui ne suivaient pas de près la campagne ont peut-être été surpris par la victoire de Rodrigo Paz, qui passe au second tour contre l’ancien président Jorge Tuto Quiroga. Les deux candidats issus du camp du gouvernement actuel, le MAS, ont obtenu de très mauvais résultats. Andrónico, est à la quatrième place et atteint 8,5% et le candidat officiel d’Arce, Eduardo Castilho, s’est classé cinquième, avec 3,1%.
Comment expliquer une telle défaite du camp dit progressiste, après des années d’un processus profond, au cours duquel le MAS était devenu une référence internationale en matière de projet politique ? Comment expliquer alors qu’un lourd coup d’État, mené par Jeanine Áñez et soutenu par des personnalités telles qu’Elon Musk, ait été déjoué ? La division et la dégradation du processus de construction politique du MAS ont été une force plus puissante dans l’« implosion » du projet que n’importe quelle force extérieure. Certains analystes parlent de « défaite endogène ».
Il est essentiel de discuter de ce qui s’est passé et d’en tirer des leçons. L’impérialisme et l’extrême droite ne se reposent pas. Outre la ligne d’intervention militaire accrue dans la région, avec des menaces croissantes, l’objectif de piller encore plus les minerais de la Bolivie, de détruire l’environnement et de faire reculer les acquis sociaux et économiques du peuple bolivien est clair. Le lithium bolivien est la cible prioritaire des capitalistes du « nouvel ordre ». Il est essentiel de discuter de ce qui s’est passé et d’en tirer des leçons, comme l’a fait Gilberto Maringoni dans un article récent intitulé « Bolivie, la défaite de la gauche ».
Ce processus n’est toutefois pas une défaite historique, car le peuple bolivien dispose de nombreuses réserves, d’une énorme capacité à coordonner la protestation sociale et tout indique que la résistance aux plans néolibéraux pourrait être plus forte qu’en Argentine sous Millei. Mais il faut garder le sens des proportions : il s’agit d’une défaite importante, qui renforce l’extrême droite sur le continent et exige l’ouverture d’un nouveau cycle pour la gauche du pays.
Des résultats impressionnants
Contre toute attente, Rodrigo Paz, du Parti démocrate-chrétien (droite catholique), est arrivé en tête avec 32,08 % des voix, contrairement aux sondages d’opinion. Jorge Tuto Quiroga, qui se présente au second tour pour l’Alliance libre, a obtenu 26,94 % des voix.
C’est la première fois depuis des décennies, depuis l’instauration du scrutin à deux tours en 2009, que le scrutin connaitra un second tour.
L’homme d’affaires Samuel Medina, qui était l’un des favoris de la bourgeoisie conservatrice et en tête dans certains sondages, est arrivé troisième avec 19,93 % des voix. Le nombre de votes nuls a atteint près de 20 %, le taux le plus élevé de l’histoire du pays.
Les candidats alignés sur le camp progressiste, reflétant la crise brutale du MAS et des processus précédents, ont obtenu des résultats médiocres. Andronico Rodriguez, président du Sénat, dirigeant issu de la base cocaleira et que beaucoup considéraient comme le successeur d’Evo, n’a obtenu que 8,5 % des voix. Le candidat officiel du MAS et du gouvernement, le ministre Eduardo Castilho, a obtenu un résultat encore pire, arrivant en sixième position avec 3,1 % des voix.
Rodrigo Paz se présente comme « centriste » ou libéral. Fils de l’ancien président Jaime Paz Zamora, il est né en Espagne et a fait carrière comme maire de la ville de Tarija, dans le sud de la Bolivie. Tuto Quiroga, quant à lui, est un politicien traditionnel qui a été président de la Bolivie après la démission d’Hugo Banzer, entre 2001 et 2002. Connu pour son profil conservateur, aligné sur la droite, il a joué un rôle international de premier plan dans le gouvernement putschiste d’Añez.
Le désastre du progressisme a été tel qu’Evo a rompu avec Andrónico et appelé au vote nul, et Arce n’a pas pu se présenter à la réélection, son représentant Castilho arrivant en cinquième position, malgré toute la machine étatique.
De l’apogée à la crise et les acquis du processus
Parmi les processus politiques qui ont été en mesure de faire face à l’usure du néolibéralisme au début du XXIe siècle en Amérique latine, la Bolivie semblait être l’une des expériences les plus solides, durables et profondes. À la tête du mouvement bolivarien, aux côtés de l’Équateur et sous l’égide du Venezuela de Chávez, le processus bolivien, incarné par le MAS et Evo Morales, a permis d’énormes avancées sociales et politiques pour le peuple bolivien.
Fruit d’un processus combinant de puissantes rébellions de masse, de nature antinéolibérale, et l’émergence de nouveaux outils politiques démocratiques, le processus bolivien a vu le jour au tournant du siècle.
La première explosion, concentrée à Cochabamba, a été la « guerre de l’eau » en 2000, où une rébellion populaire s’est prononcée en faveur de la défense de l’eau et des ressources naturelles. Un nouveau bond en avant a eu lieu en 2003, lorsque le gouvernement Sanchez de Lozada a été confronté à une semi-insurrection qui rappelait les soulèvements de 1985, lors de la « guerre du gaz », où le mouvement populaire a modifié le rapport de forces. Un référendum organisé en 2004 a donné la majorité à la défense du gaz naturel comme patrimoine bolivien, suivi de nouveaux affrontements dans les rues en 2005, qui se sont conclus par la victoire sans précédent d’un indigène Aymará, Evo Morales, aux élections de la fin de cette année-là.
La conquête de l’hégémonie a été telle que les résultats ont été évidents : outre les victoires électorales consécutives du MAS lors de trois élections présidentielles, une grande assemblée nationale constituante a été organisée, au cours de laquelle un État plurinational a été constitué et des mesures démocratiques sans précédent dans la république bolivienne ont été prises. Le contrôle des ressources naturelles était entre les mains de l’État, la pauvreté absolue et relative a diminué de manière spectaculaire, de plus de moitié en moins de dix ans. Un bond en avant a été réalisé en matière d’alphabétisation, de couverture santé et de sécurité sociale pour les retraités des mines et des zones rurales.
L’intégration régionale a été une autre avancée majeure réalisée par Evo et le MAS, avec l’adhésion à des traités régionaux et le pari sur un projet qui reprenait ce que Chavez avait relancé sous le nom de « Nuestra América ».
L’épuisement politique commence à se faire sentir lorsque la succession de 2019 est débattue, Evo s’imposant au-delà de la limite constitutionnelle du nombre de réélections, niant le résultat du référendum de 2016 et laissant des blessures parmi ses alliés et au sein de son propre parti. L’élection de 2019, officiellement remportée par Evo, laisse des traces de méfiance, de nombreux secteurs accusant des fraudes et des doutes au sein même du mouvement social. L’extrême droite, qui a toujours été active et a même organisé une campagne sécessionniste pendant les années Evo, en profite pour imposer un coup d’État, portant au pouvoir l’ultralibérale Jeanine Añez.
Un processus éphémère, bien que violent et autoritaire, car le rapport de forces empêchait un gouvernement de cette nature. La très forte résistance populaire a vaincu le coup d’État et imposé des élections directes, où le MAS est revenu au pouvoir, désormais plus divisé, avec Arce comme président, à la tête de la « branche rénovatrice », prenant ses distances avec Evo.
Pendant le gouvernement Arce, la crise s’est aggravée, avec des accusations politiques et morales de part et d’autre. La crise économique et le manque de perspectives ont pénalisé le gouvernement Arce, avec plusieurs tentatives de coups d’État, des ruptures de haut en bas, conduisant à l’érosion de sa base sociale et, par conséquent, du MAS lui-même en tant qu’outil politique.
Ce qui se passe ensuite est connu, et comme la défaite est récente, les blessures sont encore ouvertes.
Ce qui n’avance pas recule
La maxime « ce qui n’avance pas recule » s’est imposée comme une loi d’airain dans le cas bolivien. Défaite annoncée à l’avance, Arce et Evo sont tous deux directement responsables de ce recul. Ce qui était deux courants au sein du MAS s’est fragmenté en trois, avec la rupture d’Evo avec son ancien allié Andronico. Nous pouvons soulever quatre éléments pour réfléchir à ce qui a conduit à cette défaite, après avoir connu l’un des processus de changement les plus animés de la gauche au XXIe siècle :
a) Les limites de la stratégie : L’absence d’une perspective capable de changer les bases économiques et sociales de la société, et pas seulement ses bases politiques, a été fatale au MAS. Ancrée dans un modèle de développement extractiviste, où la règle était d’augmenter le revenu national pour le redistribuer dans des programmes sociaux, la limite d’une stratégie plus générale s’est fait sentir : le modèle appelé « capitalisme andino-amazonien » n’a pas été capable de viser plus haut ; il a connu le même échec que d’autres secteurs, avec une différence de temps et d’espace, comme dans le cas du Syriza grec. En ne parvenant pas à surmonter les contradictions d’un type de gouvernement, il finit par être dévoré par celles-ci.
b) L’absence d’un projet : Il n’y a pas eu de changement dans la matrice productive ; aucun effort n’a été fait pour mettre en place un nouveau type d’industrialisation, qui rompt avec les modèles économiques traditionnels et permette de créer des outils propres et liés aux préoccupations d’une transition énergétique et écologique (comme Petro semble s’en soucier, du moins en paroles). Un projet cohérent qui pourrait continuer à s’appuyer sur la démocratie directe, à la campagne et en ville, apportant des changements dans la représentation et brisant les privilèges des politiciens et des juges, appelant à une gouvernance à chaud. En l’absence d’un projet, d’autres « projets » de nature personnelle et limitée s’imposent.
c) La lutte des personnalités : le rôle des dirigeants est fondamental dans tout processus politique, il est indispensable ; cependant, la concentration des pouvoirs et la défense aveugle d’intérêts particuliers conduisent à des conflits insolubles. Voyons la dérive du Venezuela de Maduro, sans parler du pouvoir familial et autoritaire des Ortega au Nicaragua. La crise de direction se manifeste également dans l’individualisme et l’égoïsme de personnalités qui utilisent leur position de leader pour ne pas se soumettre au travail collectif et à la reddition de comptes à la base.
d) L’implosion de la lutte interne : La formation de cliques est une caractéristique de la bureaucratisation des processus. La création d’un corps de fonctionnaires qui acquiert une certaine autonomie et reflète ses propres intérêts en tant que caste, à l’insu du mouvement social et de l’ensemble du peuple, est toujours le point de départ de luttes intestines sans programme.
Leçons pour la gauche
Les leçons pour la gauche sont nombreuses. La première d’entre elles est un signal d’alarme pour les prochaines élections qui auront lieu dans la région. Le calendrier comprend les élections présidentielles à la fin de l’année au Chili, puis en Colombie, ainsi que les élections régionales et parlementaires en Argentine.
La deuxième question est d’avoir une méthodologie qui tire des leçons non seulement des succès, mais aussi des échecs. Les victoires sont motivantes, mais les échecs sont également instructifs.
Troisièmement, les risques liés à l’institutionnalisation et à la bureaucratisation, lorsqu’il n’y a pas de contrôle de la base, lorsqu’il n’y a pas de renouvellement des dirigeants, d’encouragement au débat démocratique et d’organisations vivantes, politiques et sociales, qui reflètent le mouvement des masses.
Le fameux « problème de direction » que certains élèvent au rang de catégorie abstraite, parfois caricaturale, a un coût énorme. La « crise de l’alternative » est un problème réel, qui ne peut être balayé sous le tapis, ni nous empêcher d’exercer de manière saine le processus de critique et d’autocritique.
La lutte contre l’extrême droite est acharnée et quotidienne. Tirer les leçons des processus renforce notre lutte pour vaincre les plans des néofascistes, des Trump, des Bolsonaro, des Netahyahus et des Milei.
Aux côtés du peuple bolivien
L’intéret de l’article de Gilberto Maringoni dans « Terra é Redonda » est qu’il « inaugure » en quelque sorte le débat sur le processus dans son ensemble. Il faut en débattre.
La droite va miser sur la consolidation de son triomphe, avec une préférence pour Tuto Quiroga, afin de profiter, comme Musk ne le cache pas, d’un gouvernement capable de lui livrer le contrôle de la partie bolivienne du « triangle du lithium ».
Le peuple bolivien a des réserves de lutte, avec un historique de protestations et de rébellions supérieur à celui de n’importe quel autre pays du continent. Au cours des cent dernières années, nous avons connu la première révolution ouvrière de la région, en 1952. Des soulèvements comme celui de 1971 (Assemblée populaire) et celui de 1985, lorsque les mineurs ont pris La Paz. Sans compter les soulèvements déjà mentionnés pour la défense des ressources naturelles qui ont conditionné la politique au cours des deux dernières décennies, ou même récemment, la force du mouvement populaire qui a stoppé le coup d’État. Le nombre de votes protestataires, nuls ajoutés aux votes de la gauche, un peu moins d’un tiers, est un capital non négligeable pour les batailles à venir.
La contradiction entre la bravoure du peuple bolivien et l’incapacité de ses dirigeants est la contradiction brûlante de la situation actuelle. Au milieu du deuil initial, il faut continuer et parier sur la lutte.