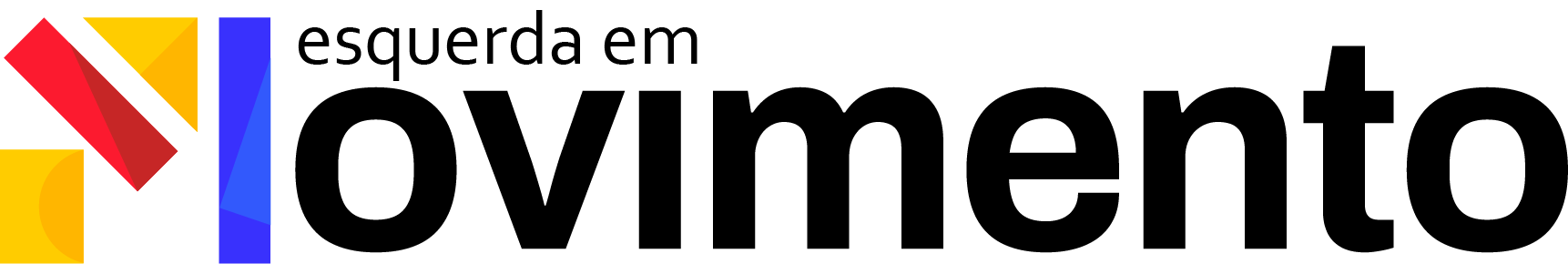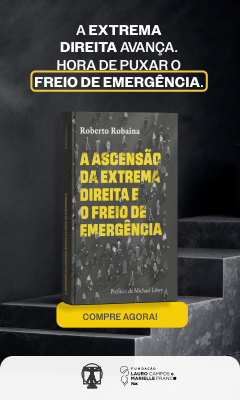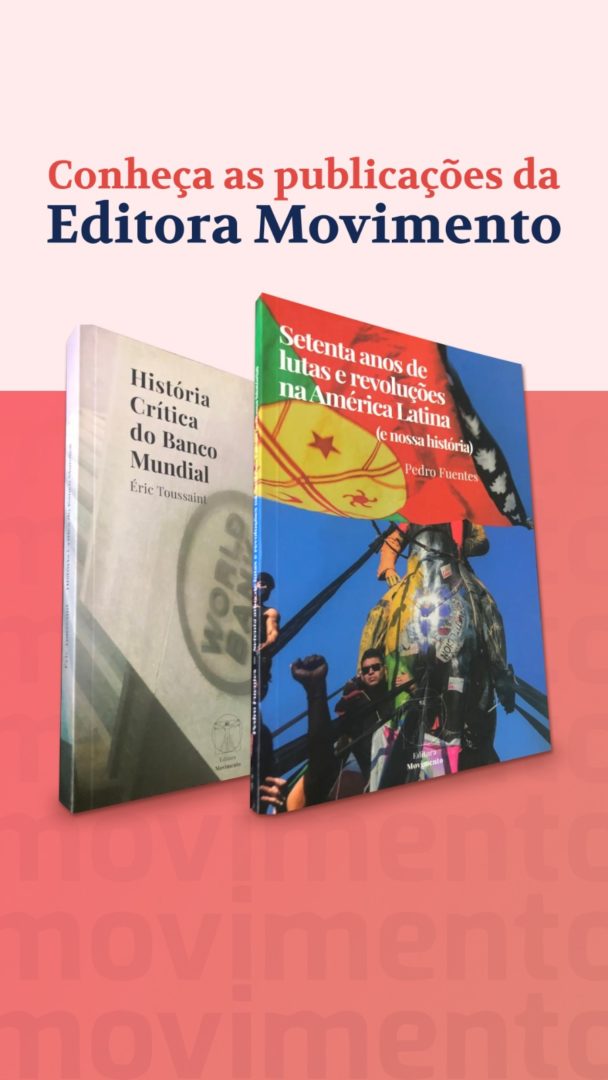Lula maintient son projet d’exploration pétrolière en Amazonie
Le projet affectera plusieurs communautés et se heurte à la résistance des écologistes et des mouvements sociaux.
Lors d’une récente rencontre avec le président du Sénat Davi Alcolumbre (União Brasil), le président Lula a explicité pour la première fois son soutien à l’exploration pétrolière sur la marge équatoriale de l’Amazone, un territoire maritime qui s’étend de l’Amapá (l’État d’Alcolumbre) au Rio Grande do Norte.
Malgré l’opposition des écologistes, y compris de la ministre de l’environnement Marina Silva, à cette exploration, et la résistance de l’Ibama (Institut brésilien de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables) à libérer le début des recherches de prospection, Lula a toujours été en faveur du projet et vient de franchir un pas décisif dans ce soutien. Cette action intervient dans le contexte de la nouvelle présidence du négationniste Donald Trump aux États-Unis et de son combat contre la transition énergétique, en favorisant l’industrie des énergies fossiles qui a financé une grande partie de sa campagne. Malgré les énormes différences entre les présidents brésilien et américain, le slogan de Trump « Drill, drill, drill ! » trouve un écho au Brésil avec nouvelles déclarations de Lula et pourrait mettre encore plus en danger le biome amazonien déjà si menacé.
L’idée du gouvernement est d’avancer au maximum ce processus dès le début de l’année 2025 pour éviter le prix politique d’une telle mesure à l’approche de la COP30 qui se tiendra à Belém en novembre. Alors que son allié Helder Barbalho (MDB), gouverneur du Pará, fait face à une importante mobilisation indigène en défense de l’actuel système éducatif pour les peuples indigènes,, il est à prévoir que cette année sera marquée par des mobilisations environnementales, alors que les yeux du monde seront tournés vers le pays hôte de la COP30.
Pourquoi s’opposer à l’extraction pétrolière à l’embouchure de l’Amazone ?
Les raisons pour lesquelles l’ensemble du mouvement environnemental s’oppose à l’exploration pétrolière et gazière dans la région sont multiples. La région abrite une biodiversité extrêmement riche et est occupée par des peuples indigènes et des communautés riveraines qui subiraient les effets directs de la mesure. Les systèmes côtiers et marins situés autour de l’embouchure de l’Amazone abritent une biodiversité unique au monde. Il s’agit d’un territoire stratégique pour la conservation, qui concentre 80 % de la couverture de mangroves du pays.
Près de 100 puits ont déjà été forés dans la région, sans aucune découverte significative. En outre, entre 2011 et 2022, le Brésil a connu près d’un accident par an lié à l’extraction de pétrole et de produits pétroliers. En 2019, l’un des principaux accidents a touché plus de 1 000 sites dans 130 municipalités de 11 États du nord-est et du sud-est du Brésil, affectant le littoral sur près de 4 000 kilomètres et plus de 5 000 tonnes de déchets ont été collectées.
L’Institut Mapinguari souligne que les recherches visant à identifier les gisements de pétrole sur la marge équatoriale impliquent le forage de puits et la collecte de matériaux, des processus qui peuvent provoquer des accidents environnementaux irréversibles. L’un des principaux problèmes est le temps de réponse aux éventuelles fuites. Selon les études réalisées par cet Institut, Petrobras prévoit de disposer de 43 heures pour contenir une marée noire, mais en 10 heures seulement, le pétrole aurait déjà atteint les eaux internationales, jusqu’à la Guyane française.
Outre la catastrophe environnementale, l’impact social d’un tel scénario serait incommensurable et toucherait principalement les populations traditionnelles qui perdraient leurs conditions élémentaires de subsistance. Il faut également rappeler que les compensations dans ces cas ne suffisent jamais à réparer de telles conséquences car l’impact est déjà tarifé à l’avance par les compagnies extractives. S’il existait une politique de réparation réellement équitable pour les personnes les plus touchées, ce type d’exploitation ne serait probablement pas viable économiquement.
Les perspectives économiques de l’exploitation sont également incertaines. Bien que les estimations suggèrent la présence de 30 milliards de barils de pétrole dans la région, , le passé récent indique suggère un scénario moins optimiste. Sur les 94 puits déjà forés à l’embouchure de l’Amazone, seuls 2 % ont enregistré la présence de carburant, et dans des volumes si faibles que l’extraction ne s’est pas avérée économiquement viable. En outre, plusieurs tentatives antérieures ont été interrompues par des difficultés techniques et des courants marins intenses, qui ont déplacé les plates-formes de forage.
Qui profiterait de l’exploration pétrolière en Amazonie ?
La principale motivation pour prendre autant de risques est d’ordre économique. Selon le gouvernement, les réserves estimées à 30 milliards de barils de pétrole à l’embouchure de l’Amazone pourraient générer des revenus de 1 000 milliards de Réais [160 milliards de Dollar US], un chiffre censé compenser les risques et les dommages collatéraux de l’exploration. Cependant, une telle position est fallacieuse, et pas seulement en raison de l’incertitude sur ces réserves évoquée plus haut.
La Petrobras dispose aujourd’hui des réserves prouvées suffisantes pour les 12 prochaines années et il est possible d’accroître la production dans la zone pré-salifère déjà en cours d’exploitation. De plus, les royalties présentées comme un bénéfice pour les sites exploités ne sont pas vraiment un « paiement » aux Etats et municipalités concernées, mais une compensation pour les impacts socio-environnementaux que cette activité extractive entraîne nécessairement. Plusieurs régions brésiliennes qui reçoivent déjà ce « paiement » souffrent des problèmes environnementaux causés par l’extraction et continuent d’afficher un faible niveau de développement social, comme le nord de Rio de Janeiro et la côte nord de São Paulo, tandis que les compagnies pétrolières maintiennent des profits stratosphériques qui vont principalement à leurs gros actionnaires.
Au milieu d’une crise climatique mondiale qui provoque des tragédies majeures et affecte de plus en plus la vie quotidienne de tout un chacun, l’appel à une transition énergétique juste est à l’ordre du jour des mouvements sociaux les plus divers, exigeant un changement du modèle de production d’énergie qui repose de moins en moins sur les combustibles fossiles. Le capitalisme mondial a déjà identifié ce besoin et cherche à marchandiser les possibilités de sortie de crise à travers un marché des crédits carbone qui génère des profits mais n’a que très peu d’impact concret sur les émissions de CO2, à l’origine du problème climatique. En proposant une rémunération pour les pays les moins polluants, cette proposition vise surtout à assurer le maintien des émissions des économies les plus polluantes et ne touche pas à la question1 centrale du réchauffement climatique.
Mais ce que propose le gouvernement Lula est encore plus rétrograde et plus proche de la politique de Trump que du soi-disant « capitalisme vert ». Son principal objectif est de satisfaire les investisseurs qui profitent non seulement de l’exploitation des combustibles fossiles, mais aussi de la spéculation sur les réserves potentielles. Lula réaffirme ainsi son engagement en faveur des intérêts de la grande bourgeoisie au détriment d’une grande partie de la population qui l’a élu.
A la veille de la COP30, il est urgent d’unir les mouvements sociaux et les différents secteurs populaires autour d’une politique qui s’oppose aux nouvelles attaques du capital contre l’environnement et les populations les plus vulnérables. La déclaration de l’état d’urgence climatique, qui garantit de véritables objectifs de lutte contre la crise climatique, est une étape essentielle, tout comme la mobilisation contre tout projet d’extractivisme prédateur. Le temps presse et les réponses concrètes à cette question ne peuvent venir que des communautés et des travailleurs les plus affectés par le changement climatique.
L’article a utilisé les données du site ClimaInfo