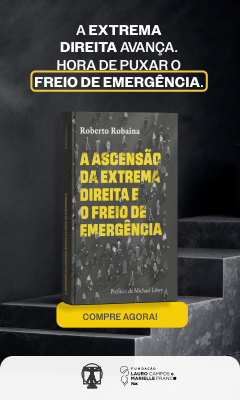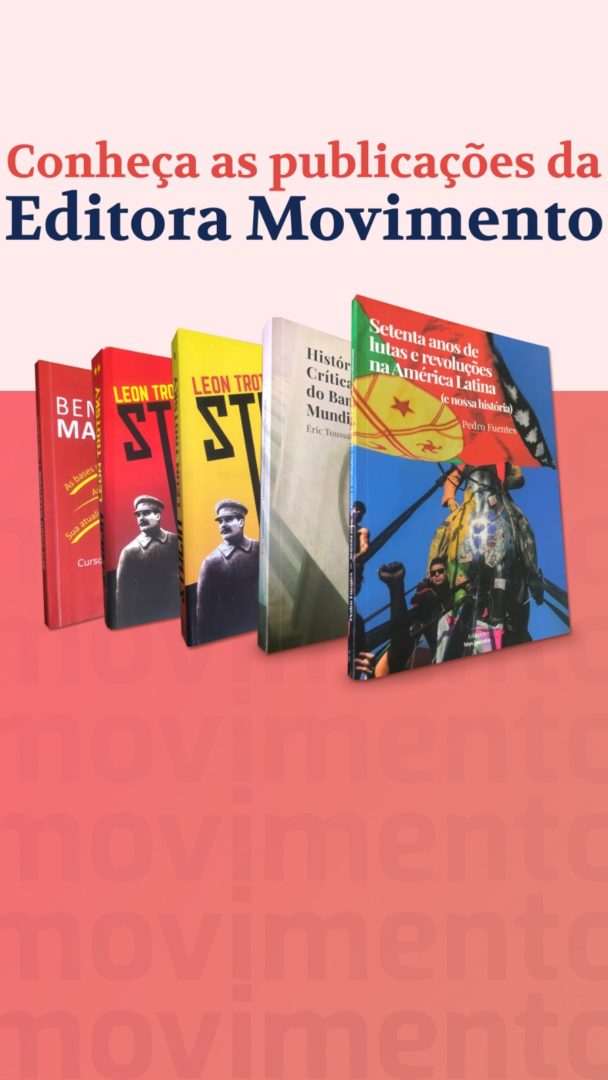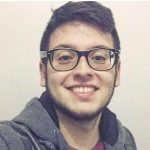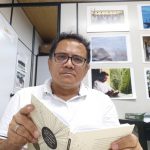Editorial: La plus grande crise de l’histoire des relations Brésil-États-Unis
La guerre tarifaire de Trump fait tomber le masque de l’extrême droite brésilienne dans un contexte encore incertain
L’Itamaraty, le ministère brésilien des Affaires étrangères, n’a laissé planer aucun doute en qualifiant cette crise de la plus grave de l’histoire des relations entre le Brésil et les États-Unis. Trump a officialisé hier le décret sur les droits de douane, qui entrera en vigueur le 6 août. Il en a profité, comme cela avait déjà été annoncé, pour utiliser le mécanisme connu sous le nom de loi Magnitsky en represailles contre [le juge] Alexandre de Moraes et la Cour suprême fédérale.
La nouvelle version des droits de douane est allégée [par rapport aux annonces initiales], ce qui conforte le gouvernement à rester ferme dans la confrontation et de chercher à isoler l’extrême droite nationale comme traîtres aux intérêts du Brésil. L’interview de Lula dans le New York Times et la déclaration officielle du gouvernement brésilien ont souligné le caractère « non négociable » de la souveraineté nationale.
Les sénateurs brésiliens ont averti que de nouvelles restrictions pourraient entrer en vigueur dans 90 jours dans le cadre des représailles contre les BRICS. Trump a déjà menacé l’Inde dans les mêmes termes.
Moraes a répondu en ne cédant pas à Trump et en prenant les sanctions pour ce qu’elles sont : une nouvelle attaque frontale contre le Brésil. Et avec Zambelli emprisonnée en Italie, le cercle se resserre autour des détracteurs qui portent atteinte à la souveraineté brésilienne.
Dans cette période de turbulences, il est nécessaire de comprendre et d’agir pour défendre les intérêts du Brésil et de son peuple travailleur.
La déshydratation des tarifs douaniers
Trump a vitupéré et menacé ouvertement, sans cacher ce qu’il voulait lorsqu’il a élevé la ligne du clan Bolsonaro au rang de politique d’État. Il a fait du cas brésilien un chapitre spécial de la guerre tarifaire qu’il mène dans le monde entier. La guerre est la politique par d’autres moyens, comme l’a dit le stratège allemand Clausewitz. Même s’il ne s’agit pas d’une guerre militaire, avec des armées, des soldats et des bombes, c’est une guerre dans le sens où elle exacerbe les conflits d’intérêts opposés. Ce n’est pas une guerre militaire, mais une guerre tarifaire.
Trump a conclu des accords importants, notamment avec le Japon et l’Union européenne, sous les réclamations de Macron. Les effets sur le Brésil, avec le décret de 50 %, sont graves, les entreprises paniquent et certaines envisagent de fermer des usines ou de décréter des congés collectifs. Le bras de fer a atteint un niveau sans précédent.
Trump a reporté de quelques jours l’entrée en vigueur de la hausse des droits de douane, désormais prévue pour le 6 août, et a ouvert près de 700 cas d’exception. Parmi les 694 articles figurent des poids lourds de l’économie brésilienne, tels que l’industrie aéronautique civile, le jus d’orange, le papier et la cellulose, les noix du Brésil, le charbon, le gaz naturel, le pétrole et ses dérivés, entre autres. Cette mesure d’allègement, bien qu’incertaine, représente environ 45 % des ventes brésiliennes aux États-Unis, retirant de la liste d’importantes entreprises de pointe telles qu’Embraer.
D’autre part, des secteurs stratégiques, principalement liés à l’agriculture, tels que le café, les fruits, mais aussi la viande et le poisson, restent sous la « guillotine » des droits de douane. Et en marge de tout ce processus, en toile de fond, se pose le problème des bigtechs et des minéraux rares. Le conflit se poursuivra et son horizon reste indéfini.
Trump n’a pas réussi à imposer totalement ce qu’il voulait et les secteurs clés de l’économie nationale sont maintenant divisés, ce qui renforce la position des négociateurs du gouvernement, tant au sein du « front institutionnel » que dans l’opinion publique. La presse libérale a attribué la crise actuelle au clan Bolsonaro et à l’intransigeance de Trump. Moraes en sort renforcé. Les pressions en faveur d’une « capitulation ouverte » d’une partie de la bourgeoisie se sont pour l’instant atténuées.
Le retour de la question anti-impérialiste a pris le devant de la scène nationale. Un niveau de « cohésion sociale » qui n’avait pas été vu depuis longtemps a relancé l’agenda politique, sorti le gouvernement de la défensive et semé la désorganisation dans les rangs de l’extrême droite.
L’arrestation de Zambelli a exercé une pression maximale, une semaine après que Bolsonaro ait été, selon ses propres mots, humilié en étant contraint de porter un bracelet électronique.
Il est possible de vaincre le chantage
Certaines certitudes ressortent déjà clairement de la réaction des analystes politiques : le Brésil s’en est bien sorti face à la pression du 1er août ; Trump devient de plus en plus la cible des peuples du monde entier, avec ses pratiques oppressives, comme en témoigne le symbole de Gaza ; l’action de Bolsonaro, du moins à court terme, s’est véritablement retournée contre lui.
Seuls 19 % de la population brésilienne voient d’un bon œil les mesures de Trump. Le gouvernement se renforce lorsqu’il affirme la souveraineté nationale.
En retirant une partie de son décret, l’impérialisme montre qu’il est fort, mais qu’il peut être arrêté. La question des BRICS et de la reconnaissance de l’État palestinien – qui a déjà trouvé un écho en France, en Angleterre et maintenant au Canada – ouvre une nouvelle voie.
L’« autre moitié » des tarifs douaniers vise de plein fouet l’agriculture. Que feront ces secteurs divisés, dont une partie soutient Bolsonaro et le coup d’État, mais qui ont pour principal partenaire commercial la Chine, grande responsable de la re-primarisation de l’économie brésilienne au cours des dernières décennies ?
La crise va se poursuivre, mais le recul de Trump indique qu’il est possible de vaincre le chantage, à deux conditions : isoler et démoraliser l’extrême droite, avec des arrestations touchant le clan Bolsonaro, et maintenir la cohésion de la société, mobilisée dans les rues et sur les réseaux sociaux. La manifestation prévue le 1er août en est un exemple : descendre dans la rue pour défendre la souveraineté nationale unifie une large partie de la population. Le mouvement ldes collégien et étudiant a raison de prendre la tête de cette lutte. Les manifestations ne doivent pas seulement être convoquées, elles doivent être construites de manière à avoir un véritable sens d’unité et de déclaration commune, capable de mobiliser des dizaines de milliers de personnes dans tout le pays.
Renforcer notre programme
C’est pourquoi nous défendons l’unité d’action, l’unité des mouvements sociaux, les actions que le MST (Mouvement des Sans Terres) a mises en place. Trump est imprévisible, de nouvelles crises se profilent à l’horizon, comme celle qui laisse présager un nouvel effondrement des bulles de l’IA.
Il est temps de renforcer notre programme, autour de tâches concrètes, qui unissent le PSOL et la gauche dans son ensemble : le référendum contre l’échelle 6×1, la défense de l’imposition des milliardaires, la lutte pour que Lula oppose son veto intégral à la « PL da Devastação » (projet de loi sur la dévastation qui simplifie á outrance les procédures d’autorisations des grands projets), et la centralité du programme de souveraineté nationale, avec des changements dans la politique économique, l’approbation de la réglementation des bigtechs et la rupture des brevets américains.
Parallèlement à cela, il faut bien sûr arrêter les putschistes du 8 janvier, mettre Bolsonaro en prison et démanteler les réseaux de soutien, de financement et d’articulation politique et communicationnelle qui porte atteinte aux intérêts du Brésil.
Les batailles à venir exigeront la ténacité et combativité. Une génération de militants se forge et accumule une expérience importante face à l’extrême droite dans le monde. La défense de la souveraineté du Brésil et la reconnaissance de l’État palestinien font partie intégrante d’une lutte qui ne fait que commencer.