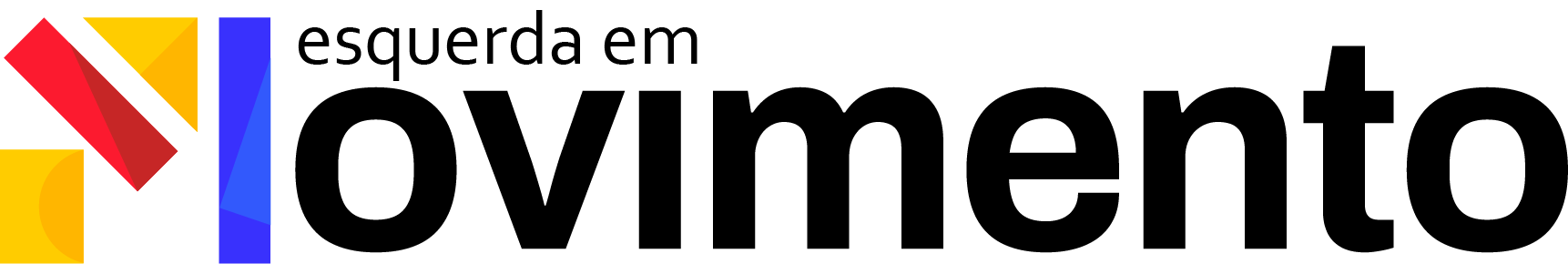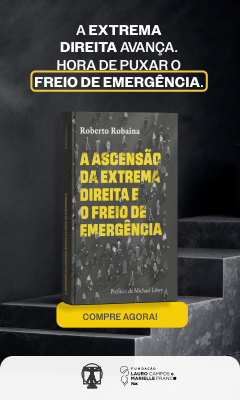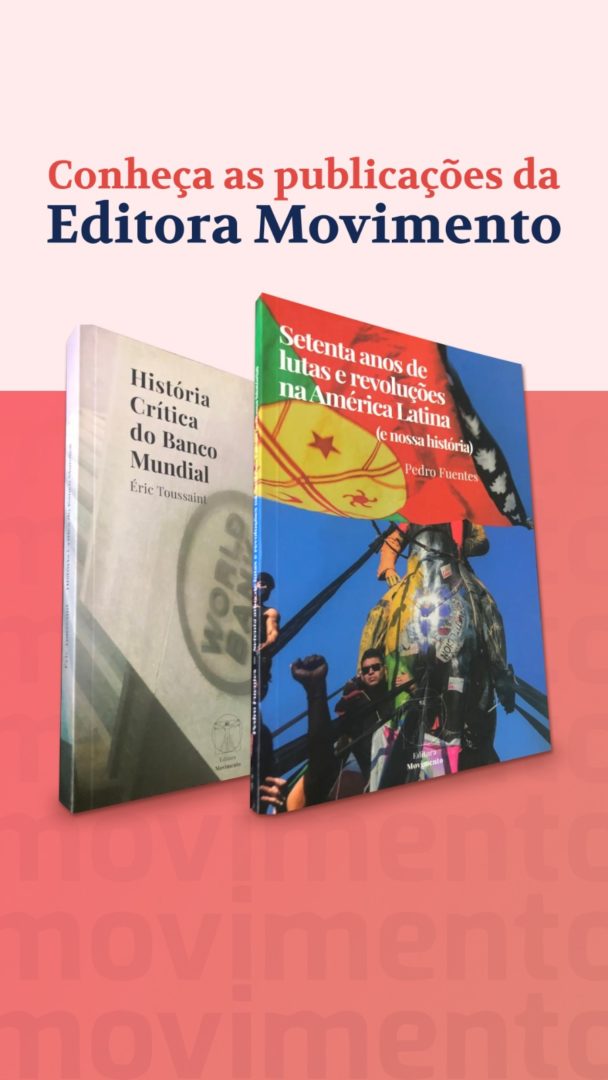Antifascisme, anti-impérialisme et internationalisme à l’ère Trump
La crise systémique mondiale s’est non seulement aggravée, mais elle s’est également accélérée ; l’«interrègne» gramscien, ce moment ou «l’ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître», est plus court que jamais.
De nombreuses questions sont en jeu en cette période et en cette ère Trump. La mondialisation capitaliste est-elle arrivée à son terme et, si oui, dans quel processus mondial entrons-nous ? Le néo-impérialisme chinois en plein essor pourra-t-il, en soutenant une politique multilatérale, réorganiser l’économie mondiale ? Quels processus pourront s’ouvrir ouverts en Amérique latine, et en particulier au Brésil, à partir de la politique de Trump ? De nouveaux gouvernements bourgeois indépendants de l’impérialisme verront-ils le jour ? Y aura-t-il des possibilités de gouvernements rompant avec la bourgeoisie, comme ce fut le cas avec Chávez et Evo, qui dépassent les progressismes actuels de conciliation avec la bourgeoisie ? Comment nous, marxistes révolutionnaires, intervenons-nous dans l’action unitaire et dans les fronts antifascistes tout en construisant une alternative anticapitaliste ? Est-il possible de construire de nouveaux partis d’influence de masse qui dépassent les progressismes ?
Il nous faut d’aborder tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés en cette période de grandes incertitudes, en étant conscients que ce n’est qu’au cours des processus et dans le cadre d’un débat ouvert qu’il est possible d’élaborer une politique révolutionnaire appropriée. Les paramètres dont nous devons débattre sont les élaborations du congrès mondial et, à partir de là, les projeter face à la situation politique mondiale qui se développe avec Trump à la tête du principal pays impérialiste. Les notes suivantes se veulent une contribution à cet effort.
1. La situation mondiale s’aggrave
La crise systémique mondiale s’est non seulement aggravée, mais elle s’est également accélérée ; l’«interrègne» gramscien, cette période où «l’ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître», est de plus en plus court. Depuis que Trump a porté la droite néofasciste au pouvoir dans la principale puissance mondiale, nous sommes entrés dans une phase de confrontations plus décisives, marquée par un désordre international croissant — guerres, division de la bourgeoisie mondiale, chocs politiques et économiques, nouvelles interventions impérialistes, d’une part, et, d’autre part, la multiplication probable des luttes de résistance, des mobilisations sociales antifascistes, anti-impérialistes et populaires.
Le dilemme « socialisme ou barbarie » se pose aujourd’hui avec plus de force. Le néofascisme est devenu une menace comparable, voire supérieure, au nazisme et au fascisme d’il y a cent ans. Ses expressions les plus dramatiques sont le génocide à Gaza — qui bouleverse de plus en plus le monde — et le déni scientifique qui pousse vers l’effondrement climatique et la possibilité de la fin de l’humanité. Le néofascisme et, plus précisément, le néofascisme impérialiste de Trump, sont le principal ennemi des travailleurs et des peuples à l’échelle mondiale, et la tâche historique est de le vaincre. Une victoire décisive sur lui ne sera possible que grâce à la mobilisation ouvrière et populaire, avec de nouvelles rébellions, insurrections et révolutions.
2. Différences entre fascisme et néofascisme
Pour comprendre la nouvelle forme du fascisme, il est bon de répondre à deux questions : qu’est-ce qui différencie le fascisme classique de Hitler et Mussolini du néofascisme actuel ? Et comment en sommes-nous arrivés à cette nouvelle forme de fascisme cent ans plus tard?
Le fascisme classique était la réponse de certains secteurs de la grande bourgeoisie à des situations révolutionnaires. Avec le soutien d’une petite bourgeoisie désespérée au milieu de crises aiguës, il a affronté la classe ouvrière avec des milices et des forces telles que la Gestapo, qui ont utilisé des méthodes de guerre civile. Il a triomphé dans des contextes d’épuisement des processus révolutionnaires, infligeant des défaites historiques au prolétariat et à ses alliés par le biais d’une contre-révolution. Ces régimes ont réussi à relancer temporairement certaines économies nationales jusqu’à la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale.
Le néofascisme actuel apparaît dans un contexte différent : la crise capitaliste est devenue chronique et combine de multiples dimensions — sociale, économique (stagnation et endettement permanent), écologique, politique (des régimes démocratiques bourgeois) et géopolitique mondiale, avec la confrontation entre l’impérialisme déclinant des États-Unis et le néo-impérialisme ascendant de la Chine. Cette crise, dans un contexte de concentration sans précédent des capitaux et des richesses, engendre une série de processus profonds qui s’expriment de multiples façons : vagues massives d’immigrants fuyant les guerres, les catastrophes climatiques et la famine, augmentation des inégalités et de la pauvreté. Le génocide de Gaza et les catastrophes climatiques sont les plus visibles.
La faiblesse organisationnelle et programmatique de la classe ouvrière amplifie cette crise. La bourgeoisie du monde entier doit mettre en œuvre des contre-réformes économiques permanentes et, pour cela, elle a besoin de régimes de plus en plus autoritaires. Une partie de cette bourgeoisie — qui comprend les super-riches des Big Tec et les monopoles des combustibles fossiles — adhèrent au néofascisme en s’appuyant sur des couches de la petite bourgeoisie et des secteurs de la classe ouvrière. Comme le dit Bellamy Foster : « … la doctrine Trump est enracinée dans de nouveaux alignements de classe associés au néofascisme du MAGA et à ses liens étroits — encore contradictoires — avec la classe multimillionnaire, en particulier dans les secteurs de la haute technologie — les grandes entreprises technologiques — et du pétrole. La base de classe du fascisme dans la théorie marxiste réside toujours dans une alliance entre le capital monopoliste et une classe/couche moyenne-basse ».
Contrairement au fascisme classique, le néofascisme ne naît pas de défaites révolutionnaires, mais de l’intérieur du régime démocratique bourgeois par le biais d’élections et ouvre la voie à des situations réactionnaires. Cela le rend plus instable que le fascisme précédent. Le cas des récentes élections argentines dans la plus grande province (40 % du pays) est illustratif. Le gouvernement Milei vient de subir une défaite écrasante dans la principale province du pays, qui regroupe environ 40 % de la population. En d’autres termes, cela provoque des réactions de toutes sortes, car il n’y a pas de défaites historiques. Si auparavant le fascisme s’appuyait sur des milices armées pour écraser les organisations ouvrières, aujourd’hui, outre l’application de mesures autoritaires et répressives qui restreignent les libertés et attaquent les organisations de classe, il dispose d’une arme plus sophistiquée : les milices numériques, capables de coloniser les consciences à grande échelle.
Même si le fascisme en tant qu’idéologie n’avait jamais disparu après 1945, il a repris de la vigueur et est devenu une menace présente et structurelle avec la nouvelle période ouverte par le krach financier de 2008, la crise de surproduction et la récession ou stagnation qui a suivi.
3. Une périodisation schématique qui explique le néofascisme
–Après la Seconde Guerre mondiale : la défaite du fascisme et la destruction des forces productives pendant le conflit ont ouvert une période de boom économique, fruit de la reconstruction. Ce cycle, accompagné de la montée en puissance des ouvriers, a contraint la bourgeoisie à accorder des améliorations sociales : c’est ce qu’on appelle l’État-providence, concentré aux États-Unis, en Europe et dans les pays impérialistes, avec un impact également en URSS et dans les États ouvriers bureaucratisés.
– La crise des années 70 : la fin de l’augmentation permanente des taux de profit et d’accumulation au cours des « 30 glorieuses » (environ 1945-1975) est devenue évidente avec la crise de surproduction de la fin des années 60, la crise pétrolière de 1973 et l’abandon de l’étalon-or par les États-Unis en 1979. La mondialisation néolibérale comme réponse du capital commence à partir de Reagan et Thatcher. Il s’agit de la déréglementation financière, avec des plans d’ajustement brutaux, des privatisations généralisées. Au cours de cette période, on assiste à un transfert de l’industrie vers l’Asie, et en particulier vers la Chine, en raison de la main-d’œuvre moins chère. Le néolibéralisme – outre les privatisations – s’est caractérisé par ce que Nahuel Moreno a défini comme une «contre-révolution économique permanente». La restauration capitaliste dans les États ouvriers dégénérés (que ce soit par effondrement, comme en URSS, ou contrôlée par le haut, comme en Chine) a été un élément essentiel de la refonte néolibérale du monde, qui a donné naissance à ce que nous appelons la mondialisation capitaliste. Continuant cela n’a pas débouché sur un processus de croissance économique, mais sur une forte augmentation de la concentration des richesses et des inégalités croissantes, le système continuant à afficher une croissance faible (à l’exception des tigres du développement et de la Chine). La mondialisation et la révolution technologique dans le cadre de la mondialisation du capital et de l’interconnexion productive et financière par voie numérique ont défini les nouvelles caractéristiques économiques et sociales de la nouvelle phase impérialiste. Mais la croissance économique est restée inférieure à ce qui était nécessaire pour assurer une accumulation sûre. La spéculation financière a dominé cette période, générant des bulles, comme celle de 1987, les krachs russe et asiatique dans les années 90, la crise des « dot-com » (2000) et la crise hypothécaire aux États-Unis, qui a entraîné la faillite de banques et de sociétés de courtage en 2008. Avec Clinton et Obama, les ajustements permanents se sont poursuivis, désormais combinés à des concessions partielles aux revendications en matière de diversité (féminisme, mouvement LGBTQIAPN+ et, dans une moindre mesure, lutte contre le racisme). Ces avancées ont été obtenues grâce à des mobilisations sociales : la nouvelle vague féministe, les luttes LGBTQIAPN+ et la révolte noire après le meurtre de George Floyd.
–2008 marque le début d’une nouvelle période historique ; depuis lors, le capitalisme est entré dans une crise chronique et multidimensionnelle : économique, sociale, écologique et politique. Le monde est devenu plus chaotique, avec des guerres (Ukraine, Gaza, Soudan, République démocratique du Congo, Myanmar), la famine et les migrations massives, tandis que le changement climatique ravage toutes les régions du monde. Le développement des forces productives se fait, paradoxalement, au prix du militarisme, de la destruction et de la mort, les rendant de plus en plus destructrices.
Le néofascisme s’est développé dans ce contexte, non seulement en raison des multiples crises, mais aussi en raison de la combinaison de ces crises avec la faiblesse du mouvement ouvrier et des masses après la chute du « socialisme réel ». Comme le souligne Roberto Robaina dans son dernier livre, le fascisme a toujours existé, c’est un courant structurel, mais il a regagné de l’importance auprès de la bourgeoisie, de certains secteurs des masses et des institutions au cours de cette période.
Pourquoi ? La bourgeoisie a de plus en plus besoin d’autoritarisme pour mettre en œuvre sa contre-révolution économique et faire face au désordre mondial : sans restriction des libertés, les ajustements ne peuvent être maintenus ; sans autoritarisme, il est difficile pour les puissances impérialistes de faire face au désordre mondial. Ce n’est pas un hasard si Trump, Meloni, Poutine, Orban, Bukele… existent.
Le néofascisme a gagné une base sociale parmi les travailleurs et les classes moyennes touchés par la crise, attirés par des dirigeants personnalistes « antisystème » et par un nationalisme réactionnaire qui, dans les pays avancés, s’appuie sur le racisme blanc anti-immigrés et, dans les pays dépendants, sur le besoin de figures autoritaires pour mettre de l’ordre dans le chaos social et l’insécurité.
4- Le gouvernement Trump : néofascisme et impérialisme néocolonial agressif
Trump incarne l’avancée du nouveau fascisme mondial. On peut dire qu’il a mondialisé le néofascisme impérialiste en prenant le pouvoir dans l’État le plus puissant du monde. Son projet combine le néofascisme national-populiste avec un impérialisme néocolonialiste agressif, qui tente de sortir les États-Unis de leur déclin.
Sur le plan intérieur, son gouvernement se caractérise par des mesures autoritaires visant à changer le régime politique. Ses mesures érodent quotidiennement les droits démocratiques acquis : persécution de ceux qui soutiennent la Palestine, nettoyage ethnique contre les immigrants qui pourraient toucher 400 000 migrants cette année, militarisation croissante de la sécurité intérieure (politique consistant à impliquer directement les forces armées dans la sécurité intérieure, comme cela s’est produit à Los Angeles, Washington et maintenant Chicago), le déni scientifique et une politique économique subordonnée aux intérêts des grandes entreprises — en particulier le noyau dur fasciste des big techs, en premier lieu, qui ont conclu un accord très étroit avec Trump, la crypto finance, le capital extractivisme et énergétique. Le Parlement a approuvé la loi budgétaire qui exempte les riches d’impôts et réduit le financement des programmes sociaux fondamentaux. Bien que son style personnel puisse sembler improvisé et erratique, sa politique — dont nous analyserons les contradictions plus loin — avance selon une logique déjà définie.
5. Une politique étrangère agressive qui désorganise encore plus l’ordre mondial.
Sur le plan international, la politique de Trump maintient l’objectif fondamental de ses prédécesseurs : retrouver l’hégémonie impérialiste face à la montée en puissance de la Chine. Cependant, elle introduit un changement qualitatif : une stratégie beaucoup plus agressive et disruptive, qui rompt les accords internationaux et les organismes multilatéraux (Accord de Paris, OMS, OMC, UNESCO, entre autres) avec des droits de douane élevés qui menacent de désorganiser les chaînes mondiales, avec une ingérence politique comme au Brésil et militaire en Iran avec les bombardements des installations d’enrichissement d’uranium et maintenant au Venezuela.
Son soutien inconditionnel au génocide et au nettoyage ethnique de Netanyahu en Palestine, l’utilisation du protectionnisme tarifaire comme moyen de chantage, ses aspirations expansionnistes délirantes (annexer le Groenland, contrôler le canal de Panama ou intégrer le Canada comme État des États-Unis), son projet de recolonisation de Gaza sous administration américaine, montrent le caractère impérialiste agressif et recolonisateur de son projet. Malgré l’imprévisibilité de ses tactiques, son esprit impérial mégalomane laisse présager un avenir de plus en plus destructeur.
En soutenant Israël, il a progressé dans la destruction de Gaza et l’affaiblissement des alliés de l’Iran au Moyen-Orient. Les bombardements sélectifs contre l’Iran pourraient être le premier pas vers d’autres interventions plus directes. Dans le même temps, ils révèlent les difficultés des États-Unis à lancer des invasions terrestres à la manière de celles menées sous les gouvernements Bush père et fils. Il n’est toutefois pas exclu qu’il recoure à de nouvelles formes d’intervention militaire plus ou moins sélectives, comme contre le Venezuela, aujourd’hui sous la menace directe d’une intervention chirurgicale ou d’un blocus soutenu par de nouvelles formes de guerre hybride.
Il est très difficile de prévoir jusqu’où ira la politique de Trump. Dans la guerre en Ukraine, Trump a commencé par favoriser Poutine, affaiblissant Zelensky et l’Union européenne, alliée historique des États-Unis, sans qu’un accord de paix ait été conclu pour l’instant. Ce qui ressort du sommet avec Poutine, c’est une recrudescence de l’offensive de l’impérialisme russe. La politique protectionniste des droits de douane a généré davantage de contradictions interimpérialistes et avec tous les pays, et par conséquent davantage de désordre dans la domination mondiale. Le génocide à Gaza suscite le rejet non seulement des masses, mais aussi d’importants secteurs de l’intelligentsia mondiale, d’institutions mondiales et même de gouvernements de manière très inégale, soulignant surtout la complicité des gouvernements européens et le silence de la Chine et de la Russie. Sa politique protectionniste et de réduction des impôts pour les riches accentue les inégalités et menace les États-Unis d’inflation et de stagnation économique. Sa politique répressive à l’égard des immigrants commence à susciter le rejet de ses propres bases. C’est pourquoi le mécontentement grandit parmi les travailleurs et la classe moyenne, comme c’est toujours le cas au sein de la bourgeoisie de son propre pays. Son destin final dépendra de la réaction et de la mobilisation dans son pays et, en ce sens, les élections de mi-mandat seront un moment important pour mesurer cette réaction.
6. Division au sein de la bourgeoisie américaine et de la bourgeoisie mondiale
Le conflit entre les États-Unis et la Chine est au cœur des multiples contradictions qui s’expriment dans un désordre mondial. Il s’agit d’un conflit entre un impérialisme décadent et un autre émergent. Nous allons maintenant nous attarder sur certaines caractéristiques du capitalisme d’État chinois, ses possibilités de réaligner ou d’attirer des pays et des secteurs bourgeois et de continuer à croître en tant que concurrent qui se présente comme le réorganisateur de l’économie multilatérale et de l’ordre mondial.
La bourgeoisie occidentale européenne souffre également de la montée du fascisme et est divisée. Bien qu’elle ait généralement besoin de plus d’autoritarisme pour mettre en œuvre les politiques d’ajustement, d’importants secteurs du capital continuent de défendre la mondialisation, le multilatéralisme et les régimes bourgeois. La résistance de ce secteur bourgeois est toutefois affaiblie car la crise exige des gouvernements bourgeois à la main dure et doit donc céder à l’extrême droite. Van der Leyden dans l’UE et Macron en France sont des exemples de cette nécessité qui se présente dans d’autres pays à mesure que l’extrême droite se développe. Les gouvernements des démocraties néolibérales, avec leurs politiques d’ajustement, créent la déception parmi les masses et ouvrent la voie au néofascisme. Mais, dans le même temps, les contradictions interbourgeoises sont fondamentales pour la politique de lutte contre le fascisme. Car elles ouvrent des brèches pour que s’expriment la mobilisation populaire, les soulèvements populaires et ouvriers qui, comme nous le savons, sont la seule façon de lutter efficacement contre le néofascisme. Dans le cas de la France, elles ont renforcé un Front populaire avec un programme progressiste et La France insoumise comme porte-parole de celui-ci.
7. L’ascension de la Chine et son rôle
Comme nous l’avons déjà dit, la polarisation mondiale trouve son centre dans la confrontation croissante entre les États-Unis et la Chine pour le leadership mondial. C’est pourquoi il est si important de définir ce qu’est la Chine et quelles sont les caractéristiques de son rôle d’impérialiste émergent. Le choc avec les États-Unis n’est pas seulement commercial, mais structurel : les deux pays se disputent les marchés, la technologie et les zones d’influence.
La plupart des analyses marxistes considèrent à juste titre la Chine comme un capitalisme d’État avec un régime bureaucratique dictatorial à parti unique. Le Parti communiste et l’appareil d’État contrôlent directement les secteurs stratégiques (énergie, transports, banques, télécommunications, armement). L’État planifie et régule, en fonction de l’accumulation du capital, avec une logique de concurrence mondiale et de recherche de profits, en tirant la plus-value de l’exploitation des travailleurs dans son pays, de la bourgeoisie chinoise qui cohabite avec la bureaucratie et des entreprises étrangères qui fabriquent également en Chine, comme Apple et Tesla. On estime qu’environ la moitié du PIB provient d’entreprises privées et de coentreprises, dont beaucoup sont intégrées dans des chaînes de valeur mondiales. L’État conserve le contrôle des secteurs clés, mais autorise et encourage un fort esprit d’entreprise national (Alibaba, Huawei, etc.). Il s’agit donc d’un modèle hybride : une forte intervention de l’État, mais dans un cadre où dominent la logique capitaliste du marché, la loi de la valeur et l’accumulation par la plus-value. La Chine est aujourd’hui la deuxième économie mondiale en termes de PIB nominal et la première en termes de parité de pouvoir d’achat. Ses grands conglomérats publics et privés (Huawei, Sinopec, Tencent, Alibaba, BYD, etc.) figurent parmi les plus grandes entreprises mondiales. Il y a eu une forte concentration de capitaux dans les banques, les industries stratégiques et les mégaprojets, et il existe une forte concurrence dans les technologies de pointe, l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables, etc.
La Chine est donc un impérialisme émergent ou un néo-impérialisme ; elle est passée d’un pays semi-périphérique à un centre d’accumulation de capital qui exporte des investissements, contrôle les marchés, établit des relations inégales avec les pays dépendants et dispute l’hégémonie mondiale, toutes caractéristiques de la phase impérialiste définie par Lénine. Bien qu’elle ne dispose pas de la domination mondiale des États-Unis, qui possèdent environ 800 bases militaires dans le monde, elle s’oriente vers un rôle de plus en plus important dans la lutte impériale dans le contexte du désordre mondial provoqué par l’administration Trump. Pour l’instant, sous des formes différentes de l’impérialisme occidental, elle se concentre davantage sur les investissements et les infrastructures que sur les interventions militaires ouvertes. Quoi qu’il en soit, la Chine renforce sa présence militaire, bien que plus limitée que celle des États-Unis, avec une base militaire à Djibouti, des patrouilles navales dans l’océan Indien et le Pacifique, une modernisation accélérée de sa marine et de son armée de l’air, défendant sa zone d’influence (mer de Chine méridionale, Taïwan, Pakistan, Afrique). Sa dernière démonstration de force lors du défilé militaire avec Poutine et Kim est une nouvelle illustration de ses intentions militaires.
La Chine exporte des capitaux financiers et entretient des relations impérialistes avec les pays dépendants. De nombreux projets chinois reproduisent la logique extractiviste d’un impérialisme d’expropriation et d’extraction dans les grands investissements miniers, pétroliers, cobalt La Chine exporte des capitaux financiers et entretient des relations impérialistes avec les pays dépendants. De nombreux projets chinois reproduisent la logique extractiviste d’un impérialisme d’expropriation et d’extraction dans les grands investissements miniers, pétroliers, cuprifères et lithiens. Elle tire profit de la génération d’échanges impérialistes asymétriques. Dans le même temps, elle tire une plus-value des usines installées notamment au Mexique et au Brésil, et ses prêts économiques aux pays sont accordés aux taux d’intérêt du marché mondial, créant ainsi des dettes et une subordination financière.
La Chine et les BRICS. Les BRICS ne sont pas une représentation du Sud global face à l’impérialisme ; ils sont très différents du tiers-mondisme des non-alignés des années 60. Pas un mot de la Chine, de la Russie et de l’Inde sur le génocide de Gaza. Comme l’écrit Zé Correa, « ils se sont renforcés en tant que réseau diffus d’intérêts nationaux pragmatiques, impulsés par des classes capitalistes qui ont connu une croissance plus rapide que celles de l’ancien noyau États-Unis-Europe-Japon coordonné par Washington. C’est la raison de l’énorme hostilité de Trump à l’égard des BRICS ». Le néo-impérialisme chinois est celui qui a le plus profité des BRICS. À présent, si l’axe Chine-Russie-Inde (cette dernière étant touchée par les droits de douane de Trump) se consolide, ce bloc réuni il y a quelques jours à Saigon deviendra une force politique et économique d’une importance considérable dans le conflit avec les États-Unis. Il est démontré que la politique étrangère de Trump ne fait que créer de nouvelles opportunités pour la Chine et son alliance stratégique avec la Russie et, éventuellement, avec l’Inde. Une partie de la bourgeoisie brésilienne exportatrice de matières premières s’oriente de plus en plus dans cette direction.
8. Dans cette nouvelle situation mondiale, la résistance et la conscience anti-impérialiste se renforcent
Au niveau mondial, un processus de résistance croissante au néofascisme se développe, avec des racines profondes qui vont au-delà du malaise social conjoncturel que la presse bourgeoise a coutume de souligner. Il s’agit d’un rejet conscient de la politique impérialiste et néofasciste, dont le point de rupture le plus visible a été la critique du génocide à Gaza.
Gaza est un tournant dans le mouvement de masse. Face à la complicité d’une grande partie des pays, y compris la Russie et la Chine, et/ou au rejet passif du génocide retransmis en direct à la télévision, des secteurs des masses se mobilisent dans le monde entier, comme cela s’est produit dans les pays européens, asiatiques et arabes. Ainsi, le génocide agit comme un déclencheur dans la conscience, même s’il est le fruit d’actions plus avant-gardistes, comme en Amérique latine. La Global Sumud Flotilla est devenue une action internationaliste comme nous n’en avions pas vu depuis de nombreuses années. La convergence de plus de 40 pays, députés et personnalités en est la preuve. Les participants à la Flottille, issus de 44 pays, témoignent de cette avancée dans la conscience d’une avant-garde des masses déjà prête à l’action internationaliste anti-impérialiste. La Flottille et les mouvements de solidarité internationale pour la Palestine sont l’expression d’une avant-garde qui se radicalise et cherche des issues en dehors des cadres du capitalisme. Greta Thunberg est un symbole de cet élan juvénile.
Aux États-Unis, les mobilisations pour la Palestine ont été un déclencheur qui a amplifié la mobilisation et cette radicalisation de la conscience. La mobilisation contre l’ICE à Los Angeles, contre No King, et contre l’intervention de l’armée à Washington. Les soulèvements de la jeunesse en Serbie, la rébellion en Indonésie et maintenant la jeunesse au Népal, deux pays où les mobilisations dans les rues sont confrontées à la répression du gouvernement, ont été une nouvelle démonstration de cette mobilisation.
De nouveaux processus politiques émergent en réponse à la crise et à l’avancée du néofascisme. Une partie des masses, déçue par l’incapacité du Parti démocrate à affronter Trump, a rendu cela possible. Dans ce contexte, des personnalités telles que Bernie Sanders et Zohran Mandani (DSA) proposent une alternative : ce dernier a même remporté une victoire électorale à New York avec un programme socialiste et de soutien à la Palestine. Bien que le DSA ne soit pas majoritaire, il constitue un point de départ pour un troisième parti des travailleurs.
L’échec des mouvements progressistes du début du siècle (Syriza, Podemos), largement cooptés par les institutions bourgeoises, ouvre la possibilité que ces nouvelles expériences, ou les partis qui conservent encore une certaine indépendance comme le PSOL, se renforcent dans ce nouveau contexte. En Angleterre, le nouveau parti de Jeremy Corbyn fait son apparition ; en France, La France Insoumise s’est renforcée ; en Afrique du Sud, une rupture avec l’ANC a donné naissance à une nouvelle organisation ; en Grèce, Zoe Konstantopoulou, ancienne présidente du parlement sous le gouvernement Tsipras, a fondé un nouveau parti et nous assisterons certainement à un processus plus large de création de nouveaux partis de gauche. Dans la situation actuelle, ces partis ou mouvements politiques peuvent prendre davantage la forme de partis anti-impérialistes et anticapitalistes. Au PSOL, une opportunité s’ouvre également pour affaiblir les nuances réformistes.
Ce ne sera pas un processus linéaire ni simple, mais les conditions sont réunies pour que, dans le cadre de la lutte contre le néofascisme, des alternatives anti-impérialistes, anticapitalistes et écosocialistes puissent être construites.
9. La lutte contre l’impérialisme en Amérique latine.
La position dans le conflit entre les États-Unis et la Chine.
Les pays d’Amérique latine, de manière inégale, restent des pays dépendants, semi-coloniaux, qui souffrent de l’oppression impérialiste. Traditionnellement, c’était l’arrière-cour de l’Oncle Sam, mais depuis deux décennies, le néo-impérialisme chinois est devenu un concurrent important. Selon les données de la CEPAL (cepal.org), l’investissement étranger direct (IED) total en Amérique latine et dans les Caraïbes s’élevait à 188,962 milliards de dollars en 2024. Sur ce total, les États-Unis représentaient 38 % de l’IED en 2024, tandis que la Chine n’atteignait que 2 % de ce flux d’investissement. La CEPAL précise dans son rapport que la valeur attribuée à la Chine pourrait être sous-estimée, car de nombreux fonds chinois arrivent via des pays tiers ou par le biais de contrats qui ne sont pas officiellement enregistrés comme IDE (cepal.org). Ils ne sont pas comptabilisés comme des IDE classiques, car ils entrent via des pays tiers, des contrats, des concessions ou l’achat d’actifs cepal.org. Le montant réel des investissements chinois pourrait être beaucoup plus élevé si l’on tient compte des prêts, des financements non enregistrés comme IDE et des accords stratégiques (tels que les ports, l’énergie, les télécommunications).
Les États-Unis ont une position dominante dans les investissements privés directs (en particulier au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale) et conservent leur hégémonie dans les investissements directs formels et le commerce avec le Mexique et les Caraïbes. La Chine domine le financement public, les infrastructures stratégiques et les ressources naturelles. La Chine : de partenaire marginal en 2000, elle est devenue le deuxième partenaire commercial mondial de l’Amérique latine en 2025, jouant un rôle de premier plan dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, des mines et de la technologie. Ainsi, la conclusion tirée des données de la CEPAL est que la carte économique est devenue double : l’Amérique du Nord (Mexique, Caraïbes, Amérique centrale) est plus liée aux États-Unis ; l’Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Pérou) est de plus en plus interdépendante de la Chine. Ces deux éléments signifient que l’Amérique du Sud reste essentiellement dans la division mondiale du travail d’exportation des matières premières.
Cette rivalité entre les puissances donne à la bourgeoisie, en particulier celle d’Amérique du Sud, la possibilité de faire des choix politico-économiques. Les secteurs bourgeois qui tentent de mener une politique plus indépendante des États-Unis ont une marge de manœuvre grâce à la Chine. Cette marge ne signifie pas un développement indépendant, mais plutôt la possibilité de manœuvrer face à la pression de l’impérialisme américain.
L’ingérence impérialiste de Trump en Amérique latine et de ses alliés néofascistes nationaux est le principal ennemi.
L’impérialisme yankee a besoin d’une politique plus agressive envers l’Amérique latine, et en particulier l’Amérique du Sud, face à l’avancée chinoise, et pour cela, il compte sur les gouvernements néofascistes qui semblent être ses sujets. Cette situation transforme la lutte antifasciste en lutte anti-impérialiste.
Les interventions de Trump ces derniers mois – d’abord au Brésil, puis bellicistes au Venezuela – ne sont pas tactiques, mais semblent être stratégiques. Le Venezuela est la plus importante réserve pétrolière du monde, avec un régime autoritaire quasi dictatorial affaibli face aux masses, ce qui facilite l’offensive actuelle. Au Brésil, en revanche, la hausse des tarifs douaniers a pour objectif explicite de favoriser son allié Bolsonaro et l’extrême droite afin de changer le régime politique. Il s’agit de l’agression la plus grave que le pays ait subie depuis l’intervention directe dans le coup d’État de 1964. Trump veut un Milei dans le pays le plus important du continent, riche en ressources minérales, en pétrole et en biodiversité. Cela sert également à affaiblir les BRICS dans l’un de leurs maillons, afin d’avoir une force stratégique face à la Chine.
La bourgeoisie latino-américaine est-elle capable, à ce stade mondial, d’affronter l’impérialisme ?
Elle peut manœuvrer, elle dispose d’une certaine marge de manœuvre, mais elle ne se placera pas à la tête de la rupture avec l’impérialisme. Si nous faisons une brève rétrospective, au début du siècle, nous avons connu une première vague de soulèvements avec de grandes mobilisations et insurrections en Argentine, en Équateur, en Bolivie et au Venezuela, qui ont conduit ces deux derniers pays à l’indépendance politique vis-à-vis de l’impérialisme. (C’est également à cette époque qu’a eu lieu la rupture avec la tentative de création de la ZLEA). Dans ces deux pays, il y a eu un changement de régime politique par le biais des constituantes et, par conséquent, une rupture politique avec les bourgeoisies respectives. Le fait que cette vague ne se soit pas étendue à d’autres pays, en raison de la bureaucratisation, des disputes entre caudillos en Bolivie et de la mort de Chávez, a entraîné une stagnation et a fini par faire reculer ces processus indépendants.
Ensuite, nous avons connu une deuxième vague de montée révolutionnaire à partir de 2017-2018 à Porto Rico, en Équateur, au Pérou et au Chili, puis en Colombie. Dans ces deux pays, les insurrections populaires ont porté au pouvoir de nouvelles organisations de gauche, Petro et Boris (Castillo au Pérou a été plus contradictoire, il ne s’est pas consolidé au pouvoir). Dans le cadre de ce processus de gouvernements progressistes, il faut ajouter les victoires de Lula, Claudia Sheinbaum et, plus récemment, du Frente Amplio en Uruguay. Il existe une différence importante entre cette nouvelle période et la précédente. Dans ces derniers cas, les gouvernements émergents n’ont pas rompu avec leurs bourgeoisies respectives et sont restés prisonniers de l’institutionnalité bourgeoise en ne promouvant pas de réformes des régimes politiques. Cela explique qu’il s’agisse de gouvernements de conciliation de classes, avec quelques réformes progressistes ; les plus avancées sont sans aucun doute celles du gouvernement de Petro, qui s’appuie sur la mobilisation populaire, tandis que les autres sont restés prisonniers et sont devenus des gestionnaires de l’État bourgeois.
Cette analyse exclut-elle la possibilité de voir apparaître des gouvernements similaires à ceux de Chávez ou d’Evo, c’est-à-dire des gouvernements qui mènent leurs pays vers une position indépendante de l’impérialisme ? C’est une question difficile à répondre et qui suscite des doutes, car un projet indépendant est difficile à réaliser à ce stade mondial de dépendance technologique et financière vis-à-vis de l’une des deux puissances et d’interconnexion des chaînes de production mondiales. Ce qui peut se produire, c’est que des gouvernements bourgeois de conciliation de classes puissent s’entendre avec des secteurs bourgeois pendant un certain temps, en s’appuyant sur le bloc chinois. En général, les bourgeoisies des pays latino-américains sont associées aux intérêts impérialistes et les plus grandes entreprises ont beaucoup de capitaux investis dans les pays impérialistes. C’est pourquoi il nous semble que seule une mobilisation populaire soutenue et une vague expansive vers d’autres pays et gouvernements radicaux, encore plus radicaux que ceux d’Evo et de Chávez, peuvent émerger, entraînant de grands affrontements avec l’impérialisme yankee. En d’autres termes, nous ne pouvons pas exclure des gouvernements plus radicaux que ceux du début des années 2000. Si une nouvelle vague révolutionnaire se produit et que les alternatives anticapitalistes se développent, cette perspective pourrait s’ouvrir, comme le prévoyait la Troisième Internationale et, plus tard, le Programme de transition.
La lutte des classes ouvre à nouveau la voie
L‘Amérique latine est entrée dans une période électorale qui a commencé par la défaite catastrophique en Bolivie, conséquence de la division-bureaucratisation du MAS et de la politique du gouvernement Arce. Cependant, nous avons ensuite assisté à la défaite écrasante de Milei en Argentine, allié de la première heure de Trump, qui applique une politique ultra-néolibérale et tentait un changement de régime. Sa défaite électorale est la conséquence du fait que son plan a commencé à s’effondrer en raison de la dépression économique, de l’endettement important, des affaires de corruption de son gouvernement qui promettait de mettre fin à la « caste politique » et du rejet populaire face à l’augmentation de la faim et de la pauvreté. Depuis son arrivée au pouvoir, les protestations ouvrières et populaires sont restées au premier plan et, lors des élections, elles ont été canalisées dans la province par le populisme péroniste et par un gouverneur qui apparaît comme la figure présidentielle du péronisme. Kicillof est un gouverneur qui a utilisé le budget de la province (le plus important de tous) pour concilier ses chefs municipaux et, contrairement à Milei, il l’a utilisé non seulement pour faire des concessions aux secteurs appauvris, mais aussi pour certains travaux d’infrastructure visant à favoriser les secteurs bourgeois et le monde rural. C’est pourquoi, lors des élections, il a également bénéficié du soutien des secteurs industriels moyens appauvris et des secteurs ruraux eux-mêmes. Le fait que le péronisme (également semi-renouvelé par la candidature de Grabois) apparaisse comme une alternative indique la faiblesse de la radicalisation et la faible capacité de la FIT à devenir une alternative de masse.
La FIT n’a pas fait un mauvais score aux élections ; elle conserve son poids dans les secteurs urbains où la classe ouvrière est importante, mais elle n’a pas encore fait le saut nécessaire pour devenir une alternative dans la lutte pour le pouvoir.
Les élections en Argentine indiquent que la lutte en Amérique latine est ouverte. L’instabilité et la précarité du gouvernement Milei peuvent indiquer les faiblesses du néofascisme pour se maintenir au pouvoir (s’il n’y a pas de défaites historiques) sur le continent et la possibilité et la nécessité de construire des alternatives anticapitalistes de masse.
Existe-t-il une possibilité de gouvernements anti-impérialistes cohérents ? Il nous semble que cela passera objectivement par une ascension révolutionnaire plus profonde que celle qui a eu lieu jusqu’à présent et par la construction d’alternatives anticapitalistes qui, pour l’instant, ne sont qu’esquissées ou inexistantes. Ce processus radical peut être construit à mesure que la crise progresse, et il ne pourrait être réalisé sans la construction d’une alternative anticapitaliste influencée par les masses. Les perspectives de gouvernements anticapitalistes – comme le propose le manifeste écosocialiste – d’un front construit grâce au pouvoir populaire sont une tâche difficile, mais pas impossible, et c’est ce qui est en jeu dans tous les pays. Cela peut être réalisé ou non, mais c’est nécessaire et l’avenir est ouvert.
10. Tactiques et stratégies
La défaite du fascisme nécessite, dans de nombreux cas, une large unité d’action, y compris le vote, comme ce fut le cas au Brésil avec Lula-Alckmin ou aux États-Unis avec Kamala. L’unité d’action signifie un accord explicite ou implicite pour une action donnée. Cela peut se traduire par des mobilisations ou des élections. C’est par exemple le cas le plus probable qui se présentera lors des prochaines élections au Brésil. Lula va sans doute esquisser des points progressistes face à l’ingérence impérialiste de Trump, mais il le fera à nouveau en alliance avec des secteurs bourgeois, comme lors des dernières élections. En d’autres termes, nous voterons pour Lula sans soutenir sa politique afin de vaincre le néofascisme bolsonariste.
Il en serait autrement si le front antifasciste avait un programme anti-impérialiste. Dans ce cas, nous aurions plus de points communs et nous pourrions construire une organisation conjointe relative pour le faire avancer, comme ce fut le cas du NPA dans le Nouveau Front populaire en France. Nous défendons l’idée que ce front en Amérique latine soit également anti-impérialiste, car l’extrême droite qui existe dans les pays dépendants est entièrement subordonnée à l’impérialisme américain. Les cas de Milei, Bolsonaro et Bukele montrent l’obéissance aveugle et la copie intégrale de cette politique, y compris le soutien sinistre au génocide en Israël.
La différence entre l’unité d’action en faveur d’un front démocratique large et un front ouvrier ou antifasciste est significative. Dans ces cas, il s’agit d’organisations et de partis qui trouvent leur origine dans les travailleurs et qui sont indépendants des partis bourgeois. Ce fut le cas, par exemple, du front unique antifasciste que Trotsky proposait en Allemagne entre le parti socialiste et le PC. Le front unique antifasciste, compris ainsi, est une forme supérieure d’unité, qui implique un certain degré d’organisation commune entre les partis ouvriers ou les secteurs petits-bourgeois radicalisés.
Dans tous les cas, les révolutionnaires doivent conserver une indépendance politique et organisationnelle totale. Dans l’unité d’action, le point commun est la nécessité de vaincre l’extrême droite. Au sein des fronts, il existe un certain programme commun et une organisation commune pour mener à bien ces points programmatiques. Mais quelle que soit l’alliance que nous formons, nous devons avoir notre organisation indépendante afin de pouvoir soutenir, face à la crise chronique du capitalisme, un programme anti-impérialiste, anticapitaliste et écosocialiste.
11. Les tâches et le programme
Comme nous l’avons dit tout au long de ce texte, le totalitarisme néofasciste, son négationnisme et la barbarie à Gaza sont en train de réveiller de nouvelles consciences. Et face à la capitulation ou à la faiblesse des directions bourgeoises et petites-bourgeoises, un espace s’ouvre pour construire des alternatives indépendantes.
Schématiquement, la gauche latino-américaine est divisée en trois positions :
Le secteur le plus réformiste estime que la solution qui s’offre aux Latino-Américains face à la crise est de revenir au développement industriel national, en considérant le bloc chinois comme la force alliée qui rendra cela possible. Utiliser les BRICS et négocier avec eux, utiliser les monnaies nationales ou construire une alternative au dollar est possible face à l’offensive yankee. Mais ni la Chine ni les BRICS ne sont la solution, car ils sont loin d’être une communauté égalitaire entre pays, mais ont plutôt été construits comme une voie essentielle à l’expansion chinoise que nous avons déjà caractérisée dans ce texte. Il s’agit de positions campistes qui, dans la plupart des cas, finissent par suivre une voie réformiste. Dans ce camp se trouvent également les organisations qui, issues de la gauche marxiste, transforment dans la pratique le front unique antifasciste en une stratégie de soutien quasi inconditionnel aux gouvernements de conciliation de classes, sous prétexte que c’est le seul rempart pour arrêter le fascisme.
Il existe un autre secteur avant-gardiste et ultra qui, face à la crise mondiale, agit essentiellement par la propagande socialiste et l’autoproclamation du parti révolutionnaire. La réalité montre que, dans la plupart des cas, cette voie conduit à la construction d’organisations qui finissent par se transformer en sectes, grandes ou petites. Nous ne pouvons pas négliger ce secteur, car, dans certains cas, il s’agit d’organisations nouvelles qui ont émergé et qui tombent dans cette politique afin de s’affirmer comme révolutionnaires et anticapitalistes.
Comme cela a été réaffirmé lors du dernier congrès mondial, nous continuons à soutenir que, dans la plupart des cas, la construction d’une organisation révolutionnaire passe par la participation à des processus plus larges qui existent déjà et qui continueront certainement à émerger dans la période à venir. Aujourd’hui, nous avons le PSOL, le DSA, beaucoup plus dynamique et moins cristallisé, ce qui pourrait se produire en Angleterre avec la formation du Nouveau Parti. La situation mondiale va de plus en plus faire émerger d’anciennes et de nouvelles avant-gardes qui, en dehors du réformisme, rompent avec la conciliation des classes et cherchent une nouvelle voie. Ce sont là les processus auxquels nous devons participer principalement pour construire loyalement ces alternatives, en y construisant consciemment des ailes socialistes révolutionnaires.
Il n’est pas facile de construire un programme anticapitaliste et écosocialiste qui permette de conquérir l’avant-garde large et de mobiliser les travailleurs. L’ancien modèle socialiste a échoué et, face à la crise, il est difficile d’en envisager un nouveau. Comme le dit le manifeste écosocialiste, la méthode du programme de transition est d’une grande actualité.
Sur la base de cette méthode, nous devons articuler un système de slogans qui avancent vers la rupture avec le capitalisme épuisé. Il n’est pas facile de construire un nouveau modèle économique pour les 99 %, mais certains slogans y contribuent. La réalité nous donne quelques points de départ. Une partie de notre classe comprend la confrontation avec le néofascisme et l’impérialisme. Des slogans de transition, certains plus timides que d’autres, ont été mis à l’ordre du jour, comme la taxation des milliardaires, popularisée par Sanders et Mandami aux États-Unis (et également présente au Brésil et dans d’autres pays) ; la nationalisation des banques sous contrôle social et des travailleurs, mesure indispensable pour freiner la spéculation et éviter la fuite des capitaux ; l’audit des dettes publiques ; contre le libre-échange, nous défendons la nationalisation du commerce extérieur ; pour récupérer le contrôle populaire sur le processus de formation des idées aliéné au profit des grandes entreprises technologiques américaines, nous proposons leur nationalisation ; pour lutter contre le néo-extractivisme, nous affirmons la nationalisation de l’exploitation minière sous contrôle populaire.
Dans le même temps, il est urgent de relier ce programme à la lutte écosocialiste contre le néofascisme et son déni scientifique. L’impérialisme et l’extrême droite, avec leur déni climatique, leurs guerres et leur course à l’armement, menacent la vie et la nature. Trump et ses alliés sont également les principaux ennemis du climat. La soi-disant « transition énergétique », impulsée par certains secteurs de la bourgeoisie, est une réponse timide et trompeuse : elle remplace les énergies fossiles par des énergies renouvelables, mais sans remettre en question la logique de l’accumulation et de la consommation illimitée. En réalité, il s’agit d’une reconversion des entreprises, dans laquelle les grandes sociétés énergétiques, minières, automobiles et technologiques se repositionnent comme « vertes », s’appropriant des subventions et de nouveaux marchés.
La proposition écosocialiste défend le contraire : une transition énergétique juste, démocratique et planifiée, sous contrôle social et non corporatif, dans le cadre d’une rupture avec le modèle capitaliste actuel de production. La construction de notre programme relie les revendications de la période, unit les plus immédiates, la lutte contre le néofascisme, aux revendications anti-impérialistes, anticapitalistes et écosocialistes très bien formulées dans le Manifeste écosocialiste de la IV, notre organisation internationale. En résumé, nous sommes antifascistes, anti-impérialistes et anticapitalistes et nous luttons pour le pouvoir populaire des travailleurs et du peuple afin de réaliser un monde écosocialiste. Une tâche difficile, mais pas impossible.
12. L’internationalisme se développe dans cette nouvelle situation
Notre adhésion à la Quatrième Internationale est une étape qualitative dans la construction du MES. Et il est très significatif qu’elle ait eu lieu à la veille de cette nouvelle période de lutte des classes, de tâches et d’engagements internationalistes accrus, à un moment où cette solidarité internationale se développe en réponse aux barbaries provoquées par le néofascisme et sa politique impériale. À l’heure actuelle, le centre de la lutte internationaliste se trouve à Gaza et, parmi les multiples manifestations, la Global Sumud Flotilla apparaît comme un exemple internationaliste de solidarité qui réunit de nombreuses organisations de 44 pays, des personnalités politiques, des artistes, des intellectuels et qui, comme le disent les trois courageux camarades qui y participent, sont imprégnés de courage face à la grande répercussion mondiale au milieu de l’escalade sioniste qui avance dans son intention d’épuration ethnique à Gaza. Cette flottille reprend l’idée des brigades internationales dont le principal antécédent historique est celui des brigades créées pendant la guerre civile et la révolution espagnoles. Il est très probable qu’à partir de maintenant, de nouvelles actions internationalistes, de plus en plus massives, se répètent et que la IV soit en première ligne. Notre tâche la plus immédiate est d’attirer de nouvelles organisations vers la IVe Internationale, et c’est une voie qui s’ouvre. Il est certain que, dans ce processus, une nouvelle internationale de masse émergera, comme le défend la IVe Internationale. Mais pour cela, il est maintenant nécessaire de renforcer la IVe Internationale afin qu’elle soit l’animatrice la plus active de cette tâche.
La COP 30, avec ses limites politiques et infrastructurelles, sera une nouvelle rencontre d’internationalistes écosocialistes. Et la principale activité de la prochaine période est la construction de la Conférence antifasciste qui se tiendra en mars à Porto Alegre (siège des premiers Forums mondiaux), convoquée par le PSOL, le PT et le PCdB du Rio Grande do Sul avec le soutien de diverses organisations, dont la Quatrième Internationale. Dans cet effort, les anti-impérialistes ont la responsabilité d’en faire un grand événement dans la lutte contre le néofascisme et l’impérialisme, un premier pas vers une nouvelle plateforme internationaliste de lutte.